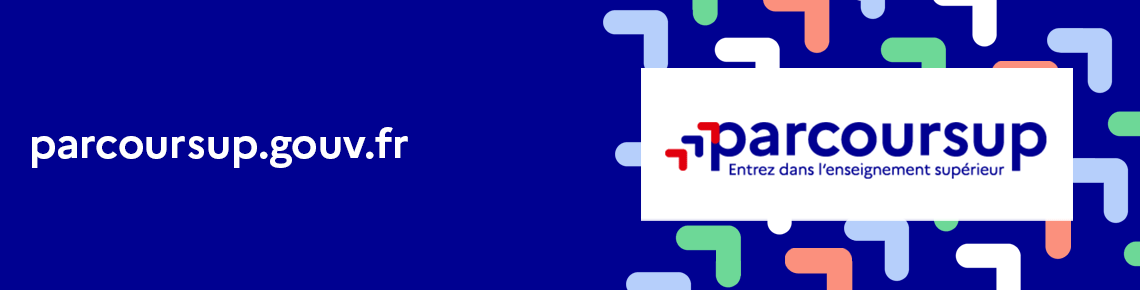Agroéconomie et politiques publiques
Piloter les transitions agricoles et alimentaires, en conciliant politiques publiques, résilience des filières et gestion durable des ressources
#agriculture #alimentation #mer #risques #environnement #entreprise #territoire #durabilité
Une formation scientifique de haut niveau pour s'emparer des transitions
La spécialisation d'ingénieur Agroéconomie et politiques publiques forme des experts en économie appliquée aux secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, aux filières agroalimentaires, et au développement régional terrestre, littoral ou maritime, capables de poser et résoudre des problèmes complexes relatifs aux politiques publiques, aux stratégies des entreprises.
Elle offre aux étudiants des connaissances et compétences en économie générale et appliquée pour s’emparer des transitions agroécologiques, alimentaires et environnementales et être en capacité de :
1 - Assurer la résilience et la durabilité des filières agricoles et alimentaires
Gestion du risque en agriculture (marchés à terme, options, assurance), aide à la décision, calcul économique et durabilité des choix d’investissement en incertain, organisation des filières et stratégie des entreprises, comportement du consommateur et alimentation.
2 - Engager les transitions de l’Europe aux territoires
Fondements économiques du développement régional, élaboration et mise en œuvre de politiques de développement territorial, littoral ou maritime, acteurs et institutions des politiques européennes, enjeux et construction des politiques (Bruxelles).
3 - S’emparer des leviers de transformation au Nord et au Sud
Évolution de la politique agricole commune, régulation des échanges agricoles et organisation mondiale du commerce, approche macroéconomique des transitions dans les pays en développement.
4 - Préserver l’environnement et gérer les ressources
Économie et intervention publique, modélisation bioéconomique, économie des ressources et de la biodiversité, politiques agroenvironnementales et climatiques, négociation et concertation territoriale, intégration terre-mer dans la gestion de l’espace maritime.
Une formation au plus près du monde professionnel
Par de nombreuses mises en situation et rencontres avec des professionnels, la formation permet d’acquérir des compétences techniques en :
- Analyse des données, outils statistiques et économétriques
- Outils d’aide à la décision pour résoudre des problèmes de décision publique et privée, en mobilisant des outils de simulation et de modélisation
- Recherche, vérification, tri, organisation et restitution d’une information scientifique et technique de façon rigoureuse
- Outils de communication professionnels : analyse et rédaction, expression orale et en public (présenter, débattre, argumenter)
- Gestion de projet : planifier, budgéter, orienter, argumenter, organiser, collaborer, respecter des délais et un cahier des charges, travailler en équipe.
Une formation tournée vers l'action
Les étudiants de la spécialisation Agroéconomie et Politiques publiques développeront des compétences pour agir et faire levier dans les filières, les politiques publiques et stratégies d'entreprise des secteurs agricoles et alimentaires. La spécialisation propose aussi une ouverture sur les thématiques de la mer et du littoral comme domaine d’application supplémentaire.
Pour l’ensemble de ces domaines, ces compétences couvrent :
- la conception, l’analyse et l’accompagnement de projets et de politiques publiques de développement, d’aménagement, de développement territorial de régulation des ressources, de préservation de l’environnement et de régulation des marchés dans les domaines de l’agriculture et de la mer.
- l’analyse prospective des filières agricoles et alimentaires, la gestion des risques, l’analyse de la concurrence sur les marchés agricoles et agroalimentaires nationaux et internationaux.
- l’évaluation économique de scénarios prospectifs portant sur le secteurs agricole et agroalimentaire, sur l’environnement économique et politique (politiques sectorielles, commerciales, environnementales), via la mobilisation d’outils de traitements quantitatifs et qualitatifs, d’analyse et de modélisation économiques.
Public étudiant français
Formation initiale
Formation à temps plein
- Spécialisation ouverte de droit aux élèves-ingénieur·es de l’Institut Agro Rennes-Angers ayant validé leur M1 en formation à temps plein.
- Spécialisation accessible à temps plein aux étudiant·es des autres établissements d’enseignement supérieur agricole (sous réserve d’acceptation du dossier). Ces étudiant·es recevront en fin de cursus un relevé de notes / crédits ECTS à remettre à leur école d’origine pour l’obtention de leur diplôme.
Formation par apprentissage
- Spécialisation ouverte de droit aux élèves-ingénieur·es agronomes de l’Institut Agro Rennes-Angers ayant validé leur M1 en formation par apprentissage.
Formation continue
- Spécialisation ouverte aux stagiaires de formation continue : salariés, demandeurs d’emploi justifiant d’une expérience professionnelle significative ou d’une certification en lien avec le thème de la spécialisation.
Elle est validée par un diplôme d’établissement.
Contact : formco.rennesangers@institut-agro.fr
Public étudiant international
- Spécialisation accessible via le concours BE (admission en L3 à temps plein) ou le concours DE (admission en M1 à temps plein) du cursus d’ingénieur agronome, d’ingénieur en alimentation, d’ingénieur en horticulture ou d’ingénieur en paysage
- Spécialisation ouverte en semestre d’échange pour les étudiant·es originaires d’un établissement partenaire de l’école. À l’issue de leur mobilité, les étudiant·es reçoivent un relevé de notes / crédits ECTS à remettre à leur université d’origine pour l’obtention de leur diplôme.
Trois semestres pour se spécialiser
Chaque semestre correspond à l'acquisition de 30 crédits ECTS. Il est composé d'unités d'enseignement (UE) qui sont constituées d'unités constitutives (UC).
Détails des enseignements en M1
4 unités d’enseignement (UE)
UE 1 • Tronc commun
- Analyse des données
- Notion de risques : évaluation, gestion et prévention
- Management, communication
- Langues étrangères LV1 et LV2, dont l’anglais obligatoire
UE2 • Individualisation des parcours
- Conduite de projet innovant
- Construire son projet personnel et professionnel
- 2 modules au choix
UE3 • Approfondissement 1
- Coordination des politiques économiques européennes et gestion des crises
- Les filières alimentaires à l’épreuve des marchés mondiaux
- Histoire de la pensée économique et théories d’économie internationale
- 1 module au choix
UE4 • Approfondissement 2
- Analyse financière des entreprises agricoles et alimentaires
- Économie de l’environnement et des ressources
- Droit rural, agricole et de l’environnement
- Microéconomie : comportement des agents économiques
Détail des enseignements en M2
Ce semestre, mutualisé avec le master E2AME, fournit les bases conceptuelles et méthodologiques pour intégrer l’économie dans la décision publique et privée. Les choix d’unités d’enseignement varient selon le cursus (ingénieur ou master).
Les approfondissements possibles :
- conception, analyse et évaluation des politiques publiques,
- modélisation économique face aux changements de marché, de réglementation ou d’environnement naturel,
- étude des marchés de matières premières, gestion des risques et concurrence agroalimentaire,
- outils macroéconomiques pour analyser les politiques sectorielles et commerciales, et leurs impacts territoriaux au Nord et au Sud.
UE 1 • Économie et modélisation
UE 2 • Outils professionnels
1 UE optionnelle
6 à 8 modules à choisir parmi 4 thèmes :
— Assurer la résilience et la durabilité des filières agricoles et alimentaires
— Engager les transitions de l’Europe aux territoires
— S’emparer des leviers de transformation au Nord et au Sud
— Préserver l’environnement et gérer les ressources
La formation se termine par un stage de fin d'études (S10) qui se déroule en milieu professionnel durant 6 mois au moins de mi-février à début septembre (24 semaines minimum). L’objectif est de valoriser les connaissances et méthodes de travail acquises au cours de la formation des semestres 7, 8 et 9, et d’acquérir des connaissances et une expérience dans un domaine vers lequel les étudiants souhaitent s’orienter.
Le stage de fin d’études a pour but d’analyser un problème dans le cadre d’un projet ou d’une étude réalisés au sein de la structure d’accueil en France ou à l’étranger. Il donne lieu à la rédaction d’un mémoire exposant l’analyse du problème et la réponse apportée, il est soutenu à l'oral devant un jury au mois de septembre.
Exemples de stage
- ADEME (Angers) - Contributions de la bioéconomie pour penser une France neutre en carbone en 2050.
- Banque Mondiale (Croatie) - Identification des secteurs agricoles-clés vecteurs de développement durable en Croatie.
- Blézat Consulting (Lyon) - Nouveaux défis techniques et économiques liés à la reterritorialisation de l’alimentation.
- CERFRANCE (Angers) - Développer des indicateurs pour évaluer la performance environnementale de la clientèle agricole
- Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire (Angers) - Étude de l’impact des évolutions climatiques sur les systèmes de production agricoles.
- Comité interprofessionnel de gestion du Comté (Ploigny) - Développer un outil d’analyse et de prévision dans le but d’améliorer l’analyse de la conjoncture économique de la filière Comté.
- Crédit Agricole SA (Paris) - Analyse de la filière lait française: rentabilité et capacité de résilience.
- Elevage sans frontières (Maroc) - Évaluation et capitalisation du projet « l’Or blanc du Haut-Atlas ».
- EY (Paris) - Importance de l’Audit Financier pour les entreprises agro-alimentaires.
- FARM EUROPE (Bruxelles) - Analyse des besoins des agriculteurs en information, définition d’un outil digital.
- IFIP (Rennes) - Proposer un OAD pour une évaluation économique et environnementale (GES) les pratiques d’élevage.
- INAO (Paris) - Analyse et prospection de données de la filière pomme ou/et volaille sous signe de qualité.
- INRAE (Paris) - Modélisation de la production de biomasse à finalités énergétique et alimentaire.
- IFPRI (Washington) - Évaluation des impacts de l’utilisation de biocarburants de seconde génération sur les usages des sols.
- LACTALIS (Laval) - Gestion Planification Organisation des stratégies d’achat.
- LIMAGRAIN (Clermont Ferrand) - Formalisation et mise à jour du processus de gestion globale des risques du groupe.
- Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - DGPE (Paris) - Effets du Brexit sur les prix agricoles.
- OREADE BRECHE (Toulouse) - Évaluation de la contribution de la PAC au bien-être animal, pour le compte de la Commission Européenne.
- PACIFICA (Paris) - Étude des nouvelles pratiques culturales et application à l’assurance récolte.
- Région Bretagne (Rennes) - Étude prospective sur les options de coûts simplifiés pour la programmation 2021-2027 du FEADER.
- TERRENA (Ancenis) - Quels indicateurs pour évaluer la performance des exploitations agricoles de demain ?
- TNS Sofres (Paris) - Analyse des comportements et perceptions des consommateurs par rapport à la distribution des produits alimentaires.
- Union des éleveurs BIO (Alençon) - Analyse et évolution de la rémunération des élevages bovins en agriculture biologique.
Des compétences recherchées
Les étudiants de la spécialisation Agroéconomie et politiques publiques développent des compétences en économie pour poser et résoudre des problèmes complexes relatifs aux politiques publiques et aux stratégies industrielles des entreprises agricoles et agroalimentaires. Elles visent particulièrement :
- l’analyse de problèmes de décision d’entreprise ou de décision publique en mobilisant des outils de simulation,
- l’analyse de données en mobilisant les outils statistiques et économétriques,
- la capacité à rechercher, organiser et citer l'information pertinente, analyser et rédiger de façon synthétique et s'exprimer en public.
Chiffres clé de l'insertion
1,2 mois pour trouver un 1er emploi
97% des diplômés trouvent leur 1er emploi en moins de 4 mois
73% des diplômés occupent des postes de cadres
77% des diplômés sont en CDI ou fonctionnaires
Salaire médian à 15 mois : 33 k€(Enquête emploi 2024, 2023, 2022)
Des secteurs d'activité et des métiers variés
De nombreux métiers sont accessibles à l’issue de la formation, dont le cœur est celui de chargé d’étude économique et peut s’exercer :
- au sein d’organisations professionnelles agricoles, de lobbys ou ONG internationaux
Une part importante des anciens étudiants agroéconomistes travaille dans les chambres d’agriculture, auprès de syndicats agricoles, d’instituts techniques sectoriels (ARVALIS…), d’institutions et de lobbies bruxellois, d’ONG environnementalistes ou orientées vers le développement au Sud.
Poursuite d'études en doctorat
Les étudiants qui le souhaitent peuvent poursuivre leurs études par un doctorat.
Des sujets de thèses sont proposés tous les ans :
- par les chercheurs et enseignants-chercheurs de de l'unité de recherche SMART dont l’Institut Agro Rennes-Angers est l'une des deux tutelles avec INRAE.
- par l’école doctorale Économie et Gestion EDGE- Bretagne dont l'Institut Agro Rennes-Angers est membre.
- au sein des administrations ou organisations publiques ou parapubliques nationales (ministères, services déconcentrés, offices sectoriels parapublics, fonction publique territoriale) ou internationales (Commission européenne). Tous les ans, quelques étudiants de la spécialisation présentent des concours de la fonction publique et notamment celui du corps des IPEF, régulièrement avec succès, ou d’un office parapublic (FranceAgriMer, CNASEA) ou expérimentent un CDD dans un ministère (agriculture, économie, environnement).
- dans les entreprises d’amont et d’aval de l’agriculture, et les services gravitant autour du secteur agricole (banque, assurance).
Ils occupent des postes d’analyste des marchés, d'acheteurs/traders ou de consultants dans les entreprises industrielles ou des coopératives et dans des cabinets de conseil (Cabinets Gressard, Oréade Brèche, Actéon…). - dans des organisations nationales ou internationales de développement (AFD, FAO, Nations Unies, Banque mondiale…), organismes de recherche (INRAE, CIRAD, IFREMER...)
Cette évolution est possible pour les étudiants qui choisissent de poursuivre leur formation par des études doctorales. Parmi les anciens étudiants agroéconomistes, certains ont passé avec succès un concours d’administrateur à la Commission européenne, sont fonctionnaires à la CNUCED ou la Banque Mondiale, régulièrement d’anciens étudiants travaillent à la FAO.